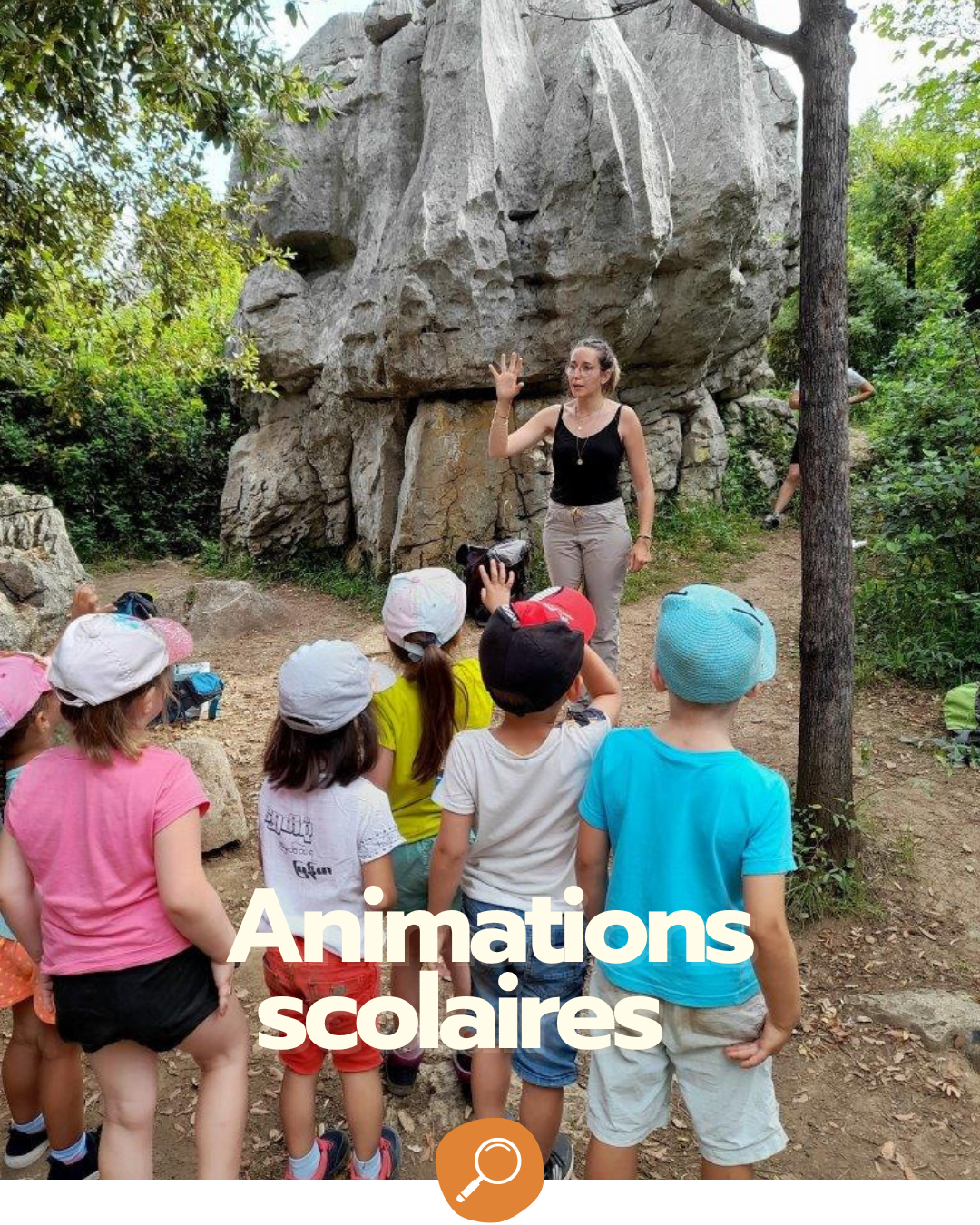Découverte de la nature
Depuis plus de 50 ans, notre association accompagne toutes les générations dans la découverte de la nature et la compréhension de ses équilibres. Sorties sur le terrain, camps de vacances, formations, études naturalistes, publications… Nous croyons à l’apprentissage par l’expérience et au plaisir d’être dehors. Ancrée dans l’Hérault, notre association réunit aujourd’hui plus de 300 adhérents, 50 bénévoles actifs et une équipe salariée engagée pour faire vivre l’écologie au quotidien.
AGENDA Nos évènements à venir

Tous ensemble pour ranger la colo !
ferme de Fiougage en Lozère
💪 On a besoin de vous ! Les colos nature de l’été touchent à leur fin… et il est temps de démonter, trier et ranger le matériel !
Vous avez un peu de temps, de l’énergie et l’envie de filer un coup de main dans la bonne humeur ? Rejoignez-nous pour le démontage du site – chaque bras compte
contact : maelys.almunia@euziere.org

Balade botanique
15h-17h Local association Domaine de Restinclières
Reprise des balades botaniques après la pause estivale. 2h pour découvrir le Domaine aux côtés de Jean-Marie Wotan passionné de botanique. Sans inscription.

Balade botanique
9h30-17h Local association Domaine de Restinclières
Reprise des samedis botaniques après la pause estivale. Une journée pour herboriser, partager un repas et arpenter le Domaine aux côtés de nos passionnés de botanique. Sans inscription, venir avec un pique-nique
Les chiffres clés de l’année 2024
8 000
curieux de nature sensibilisés
60
projets expertises naturalistes menés
+28
formations naturalistes réalisées
NOUS CONTACTER
Les Écologistes de l’Euzière
NOUS SUIVRE
Association Écologistes Euzière © Protection des données personnelles – Mentions légales